Les bilingues sont-ils des schizophrènes ?
Jonathan BENDENNOUNE, Université hébraïque de Jérusalem, Israël
Résumé
Comprendre le fonctionnement et les modalités du langage chez l’homme a préoccupé les penseurs de toutes les époques. Jusqu’à ces dernières décennies, les théories du langage ne cessent de se multiplier pour tenter de faire la lumière sur ce phénomène aussi opaque qu’évident. Cette réflexion sur le langage – opérée par le langage lui-même – s’est avérée hautement féconde, et a pu mettre en évidence notamment les profondes inégalités séparant les langues entre elles, au point que, selon de nombreux penseurs, un infranchissable fossé pourrait séparer les différents idiomes du monde. Ces fossés linguistiques, que nous effleurerons rapidement, nous conduiront à nous interroger sur la possibilité même des « passages linguistiques », autant dans le champ de la traduction, sur la scène de l’apprentissage des langues étrangères, que sur la capacité même pour un individu d’être bilingue. Dépassant le strict domaine de la théorie des langages, notre réflexion nous conduira ainsi à tenter de resituer quelques pratiques de classe de FLE dans l’éventail de ces théories.
Mots-clés : Théories du langage, diversité des langues, conceptualisation par la langue, théories de la traduction, méthodologie directe.
Conceptualisation par la langue - Diversité des langues - Méthodologie directe - Théories de la traduction - Théories du langage
Abstract
Understanding the operation and the ways and means of language has preoccupied thinkers of all eras. Until the last few decades, theories of language have continued to increase in an attempt to clarify this phenomenon as unclear as it is obvious. This reflection on language – operated by language itself – proved to be highly fruitful, and was able to highlight in particular the deep inequalities separating languages from one another, to such an extent that, according to many thinkers, an unbridgeable gap could separate the different idioms of the world. These linguistic gaps, which we will briefly touch on, will lead us to question the very possibility of “linguistic transfer”, as much in the field of translation, in the area of learning foreign languages, as in the very capacity for a person to be bilingual. Going beyond the strict domain of language theory, our reflection will lead us to try to situate some FFL class practices in the range of these theories.
Keywords : Theories of language, diversity of languages, conceptualization by language, theories of translation, direct method.
Conceptualization by language - Direct method - Diversity of languages - Theories of language - Theories of translation
Introduction
La question préoccupante du titre de cet article, quant à « l’état mental » des bilingues, ne saurait se limiter à cette saillie que l’on doit à Paul Ricœur. Derrière ce trait de sarcasme, se cache en vérité un trait de génie, soulignant combien les « échanges linguistiques » baignent dans une profonde opacité, que les théoriciens du langage sont encore bien en peine de dissiper. Une résistance semble empêcher le passage fluide et naturel d’une langue à l’autre, comme si chacune se cloîtrait dans sa propre existence, refusant obstinément de se livrer à ses pairs.
Avant de tenter de mettre en lumière cette problématique relative au rapport qu’entretiennent entre eux des langues et des locuteurs différents, ainsi que ses répercussions didactiques, nous reviendrons brièvement sur certains principes des théories du langage, en abordant le phénomène anthropologique avant la dimension sociale.
1. Brefs rappels sur les théories du langage
1.1. La vision isomorphiste du langage
Une certaine conception du langage, pour dépassée qu’elle puisse paraître aujourd’hui, n’en demeure pas moins vivace dans la pensée commune. Cette vision attribue au langage une fonction proprement objective dans son certain rapport à la réalité et aux choses – qu’elles soient réelles ou imaginaires, tangibles ou abstraites. Aux origines de cette conception, l’individu se place dans un rapport immédiat avec la réalité : convaincu de la fiabilité de ses sens, son rapport au monde lui permet de conceptualiser les choses et d’en dresser un tableau fidèle, qu’il dessine au moyen des schémas langagiers. Si l’on retrace sommairement le processus langagier selon cette vision, on pourrait le représenter selon le schéma suivant :
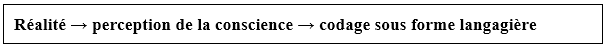
{Schéma 1} – Processus langagier selon la vision isomorphiste du langage
Plaçant l’individu à mi-chemin entre, d’une part, une réalité qui s’offre à sa conscience, et de l’autre, l’expression ou la manifestation langagière de cette réalité, cette conception linéaire et à sens unique considère le langage comme un reflet fidèle de la réalité, retranscrite au moyen du canal verbal. Il s’agit là de poser ce que l’on appelle un isomorphisme entre réalité et langage, en faisant l’impasse sur la dimension psychologique de l’individu, que les tenants de ces thèses ont pu qualifier de « mentalisme » (un terme que l’on retrouve chez les héritiers de L. Bloomfield ; voir l’article de Veken (s.d.) à ce sujet).
Si cette conception du langage a la vie dure et persiste tant dans la pensée commune, c’est vraisemblablement en raison du confort qu’elle génère. Quoi de plus sécurisant, en effet, que de tirer un trait d’union tangible et invariant entre nature et culture, affirmant une fois de plus l’hégémonie de l’homme sur les éléments. Non seulement le lexique, mais surtout les formes grammaticales de la langue, seraient le moyen le plus fiable de reconstruire cette réalité qui se donne à nos sens, par un simple transfert symbolique. C’est d’ailleurs ce que l’on trouve encore dans la plupart des dictionnaires, définissant le langage comme la « capacité, observée chez tous les hommes, d’exprimer leurs pensées » (Dictionnaire Larousse) – des pensées dûment établies, résultat d’un entendement proprement humain (dans un sens presque synonyme d’universalité).
C’est en ce sens que, comme nous le précisions, cette conception du langage se veut à la fois linéaire et à sens unique. Ces deux caractéristiques soulignent bien ce qu’implique une telle vision du langage. Linéarité signifie en effet que la perception intuitive de la réalité et la restitution verbale de cette expérience sont placées sur la même échelle : le verbe entretient avec l’action un rapport de commensurabilité, traduisant par des mots les données de l’expérience en y apposant des « étiquettes » parfaitement concordantes. Un rapport de conformité que Bertrand Russell va jusqu’à formaliser :
L’affaire essentielle du langage est d’affirmer ou de nier des faits […] Pour qu’un certain énoncé affirme un certain fait, il faut, de quelque façon que puisse être construit le langage, qu’il y ait quelque chose de commun à la structure de l’énoncé et à la structure du fait (Russell, (1921) 1993) [1].
Quant à la caractéristique de « sens unique », elle signifie que le langage peut se concevoir comme étant l’ultime produit d’un processus synthétique partant de la perception et allant jusqu’à la connaissance, dont les concepts seraient formalisés par le langage. Celui-ci serait en quelque sorte le sommet de la pyramide du savoir, permettant de sceller le sens de la réalité. À cet égard, l’empiriste John Locke appelait de ses vœux que l’humanité puisse un jour être capable d’exprimer toutes les données de l’expérience dans un langage épuré, où chaque mot aurait un point d’ancrage dans la nature, libre de tout parasitage subjectif [2]. Le langage serait en quelque sorte une photographie fidèle de ce que les sens perçoivent, pouvant être figée et jamais altérée.
Ce sont ces deux aspects de la conception isomorphiste qui, semble-t-il, ont été les plus fermement remis en cause par les théories du langage, selon les différents angles sous lesquels celles-ci sont abordées.
1.2. La diversité des langues
L’un des premiers penseurs ayant formellement remis en cause cette conception est le linguiste et philosophe Wilhelm von Humboldt. L’amorce de ses thèses originales, qui ont largement été reprises et interprétées au fil des ans, réside dans ce qu’il désigna comme la « diversité des langues ». C’est notamment le contraste entre l’allemand et le français – lequel était à ses yeux remarquablement imperméable à certains concepts abstraits – qui lui donna l’intuition d’un phénomène de conceptualisation dont la langue ne serait plus le résultat, mais bien au contraire la cause :
Ils [les mots] ont chez eux [les Français] une autre signification. Nous nous représentons sous ce terme l’opération qui laisse de côté toute expérience, toute chose donnée ; eux, seulement l’acte arbitraire visant à fixer son attention sur un objet entre plusieurs autres au sein de l’expérience (Journal parisien p. 109, cité par Chabrolle-Cerretini, 2007 : 43).
Pour lui, c’était là l’origine de la « célèbre expérience infructueuse d’expliquer aux Français la métaphysique kantienne » (loc. cit.). Une position qui peut certes sembler excessive, mais qui illustre bien le changement de perspective opéré par le penseur allemand : la langue n’est plus envisagée comme l’entéléchie de la connaissance – à savoir son ultime accomplissement – mais comme l’une de ses causes, ou tout au moins l’un des facteurs modulant la pensée.
C’est cette intuition première qu’il développera tout au long de ses recherches anthropologiques menées notamment au Pays basque, et qui lui permit d’aboutir à son célèbre concept de Weltansicht :
Par la dépendance mutuelle de la pensée et du mot, il devient évident que les langues ne sont pas des moyens pour représenter la vérité déjà connue au préalable, mais beaucoup plus des moyens pour découvrir la vérité encore inconnue. La diversité des langues n’est donc pas une diversité de sons et de signes, mais une diversité des visions du monde (discours de 1820, cité loc. cit. : 69).
1.3. Principe de relativité linguistique
À la suite d’Humboldt, les réflexions issues de ses thèses se multiplièrent et donnèrent le jour à des productions foisonnantes. C’est ainsi que vit le jour une célèbre théorie communément appelée « Hypothèse Sapir-Whorf », du nom des linguistes et ethnologues américains Edward Sapir et Benjamin Lee Whorf. Prolongeant les réflexions d’Humboldt, ces chercheurs développèrent la thèse selon laquelle la perception de la réalité serait considérablement influencée par les formatages sous-jacents dus au langage :
La psychologie moderne nous a montré avec quelle puissance le symbolisme s’empare du subconscient. Il est donc plus facile de comprendre aujourd’hui qu’il y a deux cents ans, que la pensée la plus intangible peut fort bien n’être que la contrepartie consciente d’un symbolisme linguistique inconscient (Sapir, 1921 : 16).
Ces théories seront plus systématiquement formalisées par Whorf, qui les définira comme un principe de « relativité linguistique », posant que le langage ne serait pas moins l’expression de la pensée que son principe formateur :
Nous découpons la nature selon les tracés que notre langue a dessinés sur elle […] Nous sommes ainsi confrontés à un nouveau principe de relativité, selon lequel les mêmes preuves physiques ne conduisent pas tous les observateurs à la même image de l’univers, à moins que leurs ressources linguistiques ne soient similaires (Whorf, Language, Thought and Reality, cité par Fortis, 2010 : 2).
Whorf lui-même s’efforça d’appuyer sa thèse sur une expérience empirique, menée auprès de la peuplade des Hopis, des Indiens de l’Arizona. La structure de leur idiome impliquerait une conceptualisation de l’espace, du temps et de l’événement nettement différente de celle généralement présente dans les langues européennes. Or, si deux langues ne conceptualisent pas l’espace ou le temps de manière identique, c’est forcément que leurs locuteurs respectifs « ne pensent pas de la même façon ». Quoique cette différence n’ait pas pu être démontrée, elle indique néanmoins qu’aux yeux de Whorf, l’effet-langue pourrait affecter même la manière dont les peuples se représentent des concepts aussi essentiels que ceux de l’espace et du temps.
Dans cette lignée, des expériences ont été menées auprès de peuplades dont la perception des couleurs serait réduite précisément en raison de la pauvreté lexicale de leur parler. On rappellera les travaux d’Eleanor Rosh auprès des Danis de Nouvelle-Guinée, qui catégorisent les couleurs selon un lexique extrêmement réduit, et ceux d’Eric Lenneberg, réalisés auprès des Zuni du Nouveau Mexique, qui ne distinguent pas le jaune de l’orange.
1.4. De la conceptualisation langagière
Outre ces quelques rappels relevant du domaine de la linguistique, d’abondantes critiques du langage ont également été formulées par les philosophes tout au long des siècles (en mettant essentiellement en relief l’opacité du langage et son incapacité à refléter la subtilité de nos pensées, comme le fera notamment Bergson). Mais c’est Friedrich Nietzsche – philologue avant d’être philosophe – qui aura probablement émis les critiques les plus radicales contre le langage et sous un angle particulièrement original. Son analyse met en évidence le fait que la langue exerce un effet corrupteur sur la conscience, au point que bon nombre de nos croyances, valeurs morales et autres principes normatifs de la pensée (notamment occidentale) lui sont directement imputables. D’après lui, les suggestions implicites du langage sont telles que nos interprétations de la réalité sont directement fonction des tromperies induites par notre manière de parler. La langue étant un agent de conceptualisation, les mots disent des choses auxquelles nous sommes involontairement portés à croire, pour la simple raison que nous sommes incapables de formuler la réalité différemment.
Dans un aphorisme de Par-delà bien et mal (§ 54), il souligne notamment l’effet pervers d’une grammaire fondée sur la corrélation entre un sujet et un verbe :
Jadis on croyait à “l’âme” comme on croyait à la grammaire et au sujet grammatical : on disait : “Je” est condition, “pense” est attribut et conditionné ; – penser est une activité, à laquelle il faut supposer un sujet comme cause (Nietzsche (1886) 1898 : 67).
Dans La Généalogie de la morale (§ 13), Nietzsche précise davantage les implications des structures grammaticales fondées sur un sujet prédiqué :
Il ne peut paraître autrement que grâce aux séductions du langage (et des erreurs fondamentales de la raison qui s’y sont figées) qui tiennent tout effet pour conditionné par une cause efficiente, par un “sujet” et se méprennent en cela […] comme si derrière l’homme fort, il y avait un substratum neutre qui serait libre de manifester la force ou non. Mais il n’y a point de substratum de ce genre, il n’y a point d’“être” derrière l’acte, l’effet et le devenir (Nietzsche (1887) 1908 : 67).
En somme, ce que Nietzsche place ici sur le banc d’accusation, c’est ce conditionnement de l’esprit dû à notre manière d’exprimer les choses. Chacune de nos phrases étant composée d’un sujet et d’un verbe, nous admettrions implicitement que sujet et action fussent deux entités distinctes, que l’Être – une substance possédant des caractéristiques constitutives, des propriétés inaliénables – est avant d’agir. Ce système de pensées préconçues, c’est le langage qui nous l’aurait légué, drainant avec lui des concepts métaphysiques tels que Dieu, l’âme ou les valeurs morales adoptées par notre civilisation [3].
Mais laissons là ces spéculations nietzschéennes, qui prennent essentiellement pour cible la tradition métaphysique. Quels que soient les dogmes tenus pour la conséquence de certaines structures langagières, ces réflexions nous offrent tout au moins une mise en perspective quant à la relation entre connaissance et langue. En effet, ce que l’auteur de Zarathoustra met en lumière, c’est le fait qu’un système langagier influe directement ou indirectement sur notre manière de penser, notre conception et, par là même, notre perception de la réalité. Inconsciemment, nous devenons les victimes de notre propre langue, laquelle distille subrepticement dans notre esprit des suggestions dont nous serions bien en peine de démêler les effets. On peut ainsi parfaitement conjecturer que les formes grammaticales rigides de nos langues, ou encore des éléments lexicaux souvent fort indigents, emprisonnent notre esprit dans une relation bien particulière à la réalité, une relation qui serait de facto spécifique à nos latitudes linguistiques. Si bien qu’il n’est nullement invraisemblable d’avancer que les locuteurs d’une langue possédant des propriétés nettement différentes, conçoivent un découpage de la réalité tout aussi radicalement différent. Ainsi, des concepts aussi fondamentaux que l’espace et le temps – que Kant définit comme des formes a priori et universelles de l’intuition humaine (Kant (1787) 1944 : 33), conditions de toute expérience empirique – pourraient eux-mêmes adopter mille et une formes, en fonction des diktats et des découpages implicites de la langue [4].
2. Les « passages » d’une langue à l’autre
Ces brefs rappels nous permettent désormais d’aborder la question de ce que nous avons désigné – non sans jouer sur les mots – comme les « échanges linguistiques ». Si, à la suite des penseurs évoqués et de nombreux autres qui ont poursuivi leur réflexion, nous admettons que toute langue implique nécessairement une « vision du monde » spécifique et un système de pensée distillé à travers ses formes particulières, tout passage d’une langue à l’autre devrait supposer une adaptation et des glissements conceptuels de divers ordres.
2.1. Traduire, apprendre et parler
Par « passage » d’une langue à une autre, nous devons entendre non seulement la question de la traduction, mais aussi celle de l’apprentissage de langues étrangères, et même le fait pour un individu de s’exprimer en deux langues différentes. De fait, l’exercice de traduction implique nécessairement de sonder le cœur de tout texte, pas seulement ses composants textuels, mais surtout les conceptions artistiques, affectives ou encore idéologiques qui en émanent. Pour ce qui est de l’apprentissage des langues étrangères – auquel nous consacrerons quelques lignes dans la suite de notre réflexion – il s’agit pour l’apprenant d’être à même de se détacher du mode de pensée de sa langue première, pour pouvoir s’imprégner de celui de la langue étudiée. À la lumière de nos précédentes réflexions, les enjeux de ces deux types d’exercices prennent une connotation dramatique : dans un cas comme dans l’autre, il s’agit en effet de jeter un pont entre deux systèmes conceptuels qui pourraient s’avérer radicalement différents, sans jamais avoir la certitude que ce pont puisse seulement être produit.
Quant aux individus bilingues, ils constituent assurément la plus déroutante énigme que met au jour cette analyse : comment un même individu, doté d’une conscience relativement régulière, égale et équilibrée, peut-il évoluer simultanément dans deux systèmes foncièrement différents ? Comment peut-il envisager l’Être à la fois comme une substance et comme une qualité de l’existence ? Concevoir le temps à la fois comme un concept de forme linéaire et géométrique, et comme une expérience émanant des affects de notre conscience ?
C’est dans ce contexte que s’inscrit le trait d’esprit de Paul Ricœur par lequel nous avons introduit cet article, et dont nous comprenons désormais l’enjeu :
Si vous ajoutez l’idée que chaque découpage linguistique impose une vision du monde […] alors c’est l’ensemble des rapports humains des locuteurs d’une langue donnée qui s’avère non superposable à celui de ceux par lesquels le locuteur d’une autre langue se comprend lui-même en comprenant son rapport au monde. Il faut alors conclure que la mécompréhension est de droit, que la traduction est théoriquement impossible et que les individus bilingues ne peuvent être que des schizophrènes (Ricœur, 2004 : 28-29).
Sur la base de ces réflexions, une longue tradition de théories en traductologie ont énoncé une alternative dont les deux termes sont aussi peu satisfaisants l’un que l’autre. Le premier consiste à ployer sous la force des arguments théoriques et d’admettre que traduire est tout bonnement impossible. Pas simplement qu’une bonne traduction soit impossible, mais que l’exercice même ayant pour objet de restituer un texte d’une langue dans une autre est fatalement voué à l’échec. Cette école de pensée a eu une telle audience que « la tendance lourdement prédominante est de conclure à l’impossibilité théorique de traduire » (Ladmiral, 1979 : 85). Si bien que, pour élargir ces conclusions à nos autres champs d’investigation, l’apprentissage d’une langue étrangère serait une impossible gageure et les bilingues constitueraient un phénomène inexplicable. Une autre école de pensée, rejetant l’analyse théorique, énonce le deuxième terme de l’alternative en s’en tenant aux faits empiriques : les traductions existent de facto, les hommes ont de tout temps eu des échanges interlinguistiques et les polyglottes ont marqué l’humanité depuis les temps les plus reculés. En somme, on pourrait s’exclamer en paraphrasant Galilée : « Et pourtant on traduit… »
Alors finalement, comment concilier ces faits empiriques, avec la réalité non moins empirique de la diversité des langues ? À en croire Ricœur, l’unique explication consisterait à créditer la thèse d’une protolangue, qui serait à l’origine de tous les idiomes parlés et qui renfermerait en substance toutes les conceptualisations possibles chez l’humain. C’est le mythe de Babel ressurgissant là où on ne l’attendait pas, celui d’une ère d’unité universelle assurant une cohésion imprescriptible entre les civilisations. Un mythe attribuant un facteur nuisible à la diversité des langues qui, loin de manifester l’infini spectre de la pensée humaine, témoigne du dispersement d’une universalité primaire unique et unie. Cette thèse, soutenue notamment par Walter Benjamin dans La Tâche du traducteur, admet que les fossés séparant les langues ne sont pas le fait de structures conceptuelles radicalement divergentes, mais bien de notre incapacité à les combler, de notre regrettable inaptitude à atteindre cette « langue pure » et originelle dans laquelle tous les peuples pourraient se retrouver [5].
En définitive, force est d’admettre que la théorie peine à rejoindre les faits, sans qu’aucune alternative ne semble à même de résoudre l’énigme. Pour conclure, laissons là encore le dernier mot à Ricœur :
La traduction s’inscrit dans la longue litanie des “malgré tout” […] En dépit de l’hétérogénéité des idiomes, il y a des bilingues, des polyglottes, des interprètes et des traducteurs (loc. cit. 33).
2.2. Des pratiques de classe
Si le problème semble relever de l’insoluble antinomie, nous tenterons néanmoins d’en dégager une courte réflexion relative à l’enseignement des langues étrangères et à nos fameuses « pratiques de classe ». En résumant brièvement les lignes précédentes, l’alternative semble être la suivante : soit toutes les langues naturelles possèdent un fond commun, au point que le système conceptuel de chacune se retrouverait potentiellement dans les autres ; soit le fossé les séparant, bien qu’irréductible, n’est néanmoins pas infranchissable, le phénomène de « multi-conceptualisation » chez un même individu devant de facto être admis.
Rapportée sous un angle didactique, cette problématique n’est pas sans conséquence quant à l’approche adéquate à adopter pour l’apprentissage et l’enseignement des langues étrangères. Selon le premier terme de notre alternative, il faut en effet admettre que l’apprenant possède, au sein de sa langue première, les bases conceptuelles lui permettant de s’ouvrir aux « visions du monde » de toute autre langue, ces bases sous-jacentes nécessitant simplement d’être activées ou actualisées. Ainsi, même si la langue source semble ignorer certains concepts ou en avoir une approche radicalement différente de celle de la langue cible, cette opposition ne serait que superficielle. Visiblement, elle serait simplement le fait de l’analyse subjective d’un individu parlant, lui-même soumis au mirage de sa propre langue qui lui montre un fossé linguistique là où il n’y en a pas. En revanche, selon le second terme de l’alternative, ce fossé conceptuel serait certes avéré, mais il serait surmontable non pas grâce à la langue première, mais en dépit d’elle. Il faudrait alors envisager chez l’apprenant une nécessaire déconstruction de ses automatismes langagiers, laquelle l’inciterait à contourner les chemins de sa L1 pour être à même de s’approprier les concepts propres à la L2.
Pour le dire concrètement, si l’on souhaite enseigner l’être – que ce soit le verbe dans sa fonction d’auxiliaire ou de copule, ou encore les concepts qui en découlent – à un locuteur d’une langue qui ignore ces valeurs linguistiques, deux choix s’offrent à nous. Selon la première option, il conviendrait d’aller puiser aux sources de sa L1 – chacune selon ses différentes articulations – pour retrouver des germes du concept être. Prenons l’exemple de l’hébreu, qui se contente de juxtaposer le sujet et le prédicat là où le français emploie la copule être. Même là, il serait possible d’emprunter en hébreu la voie du passé ou du futur – lesquels sont effectivement marqués par la déclinaison d’une copule qui s’apparente à celle d’être – pour éclairer notre apprenant. Mais si, au contraire, nous assumons qu’un fossé linguistique sépare ces langues, une telle approche pourrait s’avérer contre-productive. En effet, un tel procédé serait, au mieux, un expédient peu fiable, et dans le pire des cas, on inciterait l’apprenant à conceptualiser un mot de manière erronée, en le rattachant à une idée de sa langue première qui ne correspond pas à celle recherchée. Pour reprendre notre exemple, il s’avère en effet que lesdites copules en hébreu sont exclusivement employées pour marquer le temps. Or, rien ne nous assure que dans l’esprit d’un hébréophone, elles ne s’inscrivent nullement dans le système conceptuel d’être, et qu’elles constituent uniquement des marques de temporalité. Selon cette vue, il conviendrait au contraire de créer chez l’apprenant une nouvelle abstraction correspondant au concept visé – par l’une des mille ressources que les professeurs de FLE savent si brillamment tirer de leurs manches –, en évitant précisément d’avoir recours aux moyens offerts par la langue première.
On l’aura compris, la question de l’adoption de la méthodologie dite « directe » est au cœur de cette opposition. Cette méthodologie, qui s’est imposée au début du XXe siècle et qui continue d’être pratiquée avec plus ou moins de fidélité dans de nombreux établissements, prône en effet un enseignement réalisé exclusivement en langue d’apprentissage, en évitant, pour les plus orthodoxes, d’avoir le moins du monde recours à la langue première. Selon la première vue précitée, contestant la réalité du fossé linguistique, cette approche didactique demeure un choix optionnel, auquel on souscrira selon qu’on adhère ou non à ses arguments. En revanche, selon la seconde vue, il semble impératif d’adopter cette méthodologie, pour éviter toute distorsion conceptuelle des éléments linguistiques enseignés.
Les répercussions de cette dichotomie sont encore nombreuses dans les pratiques de classe. Il en est ainsi des méthodes dites onomasiologiques et sémasiologiques – consistant respectivement à aller du sens vers le mot, ou du mot vers le sens – et où l’accent est placé soit davantage sur l’effort d’abstraction, soit sur la valeur des éléments linguistiques. Mais nous ne nous attarderons pas davantage sur les exemplifications. Ce que nous aimerions retenir de cette réflexion, c’est le fait que l’intérêt des différentes méthodes et approches adoptées en classe de langues étrangères ne se résume pas à leur fiabilité pratique et à leur efficacité plus ou moins démontrée. Il importe de prendre conscience du fait que le phénomène du langage est et demeure à bien des égards une énigme que l’on peine à démêler, et que la part d’inconnu dans le processus d’apprentissage des langues – étrangères ou non – n’est probablement pas moindre que celle déjà dûment théorisée.
Notes
[1] Notons que, dans cette introduction au Tractacus de Wittgenstein, Russell conclut cette sentence par : « C’est là peut-être la thèse la plus fondamentale de la théorie de M. Wittgenstein. » Une affirmation à laquelle l’auteur de l’ouvrage – disciple et ami de Russell – se désolidarisera, allant jusqu’à refuser de faire éditer cette introduction dans son ouvrage.
[2] « Je ne doute point que, si nous pouvions conduire tous les mots jusqu’à leur source, nous ne trouvassions que dans toutes les Langues, les mots qu’on emploie pour signifier des choses qui ne tombent pas sous les Sens, ont tiré leur première origine d’Idées sensibles. D’où nous pouvons conjecturer quelle sorte de notions avaient ceux qui, les premiers, parlèrent ces Langues-là, d’où elles leur venaient dans l’Esprit et comment la Nature suggéra inopinément aux hommes l’origine et le principe de toutes leurs connaissances, par les noms mêmes qu’ils donnaient aux choses » (nous soulignons) (Essai sur l’entendement humain (1689) 1822, tome III 203). On retrouve une ambition similaire également chez Leibnitz.
[3] Voir à ce sujet l’article exhaustif de Scarlett Marton : « Le problème du langage chez Nietzsche. La critique en tant que création », Revue de métaphysique et de morale, vol. 74, n°2, 2012, pp. 225-245.
[4] Dans cet ordre d’idées, Gustave Guillaume, qui consacra une large partie de ses recherches à la psychomécanique verbale du temps, démontra que le temps ne saurait être conçu autrement que sous le modèle de la spatialité : « L’esprit humain est ainsi fait qu’il a l’expérience du temps, mais n’en a point la représentation. Il lui faut la demander à des moyens constructifs et descriptifs qui sont de l’ordre de l’espace » (Guillaume (1945) 1965 : 17).
[5] Une variante de cette hypothèse consisterait à envisager l’ensemble des facultés langagières, et de leurs innombrables ramifications, comme une compétence a priori que chaque individu posséderait intuitivement ; ou, pour le dire dans les termes des écoles de la grammaire générative, comme une faculté innée inscrite dans le génome humain. Cette hypothèse supposerait néanmoins que cette faculté soit représentée non seulement au niveau des grammaires, mais aussi des systèmes lexicaux et phonologiques de toutes les langues du monde, chose à laquelle ces écoles elles-mêmes ne semblent manifestement pas adhérer.
Références bibliographiques
Chabrolle-Cerretini, A.-M. (2007). La vision du monde de Wilhelm von Humboldt : Histoire d’un concept linguistique. Lyon : ENS Éditions.
Dictionnaire Larousse (s.d.). Version en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
Fortis, J.-M. (2010). « De l’hypothèse de Sapir-Whorf au prototype : sources et genèse de la théorie d’Eleanor Rosch » in Corela 8-2, 2010. Repéré à : http://journals.openedition.org/corela/1243
Guillaume, G. 1965. L’architectonique du temps dans les langues classiques (1945). Réédité par Roch Valin. Paris : Librairie Honoré Champion.
Kant, E. (1944). Critique de la raison pure. 2e éd. (1787). Paris : Presses Universitaires de France.
Ladmiral, J.-R. (1979). Traduire : Théorèmes pour la traduction. Paris : Payot.
Locke, J. (1822). Essai sur l’entendement humain (1689). Édité dans Œuvres philosophiques de Locke, réédité par M. Thurot, Paris.
Nietzsche, Fr. (1887). La Généalogie de la morale. Paris : Mercure de France.
Nietzsche, Fr. (1908). Par-delà le bien et le mal (1886). Paris : Mercure de France.
Ricœur, P. (2004). Sur la traduction. Paris : Bayard.
Russell, B. (1993). Introduction in Tractacus Logico-Philosophicus de L. Wittgenstein (1921). Traduction française. Paris : Éditions Gallimard ().
Sapir, E. (1921). Le langage, Introduction à l’étude de la parole. Traduit de l’anglais par S.M. Guillemin.
Veken, C.H.(s.d.). « BLOOMFIELD Leonard (1887-1949) », in Encyclopædia Universalis. Repéré à : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/leonard-bloomfield

